|
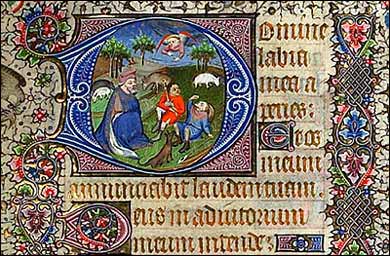

Un livre d'heures du XVe siècle vient d'entrer dans les collections
de la BnF. Ce manuscrit enluminé, 272 feuillets, est d'une
rare richesse iconographique - 54 peintures, 24 petites illustrations,
trois initiales historiées- dues à plusieurs artistes
différents. Un précieux document pour l'histoire de
la peinture et de la société de l'époque
Le livre d'heures de Jacques II de Châtillon, du nom de son
premier commanditaire, est exceptionnel à plus d'un titre.
Deux familles successives y ont laissé leur marque ; Jacques
II de Châtillon et sa femme Jeanne Flote qui firent exécuter,
dans le deuxième quart du XVe siècle, le noyau primitif
de l'ouvrage ; puis vers 1470-1480, Louis de Roncherolles, noble
du Vexin, à l'occasion de son mariage avec Marguerite de
Châtillon l'enrichit de plusieurs peintures. Il est rare qu'un
document porte autant de marques de ses commanditaires.

"Ce manuscrit est un document important pour l'histoire
de l'art au XVe siècle, commente François Avril,
conservateur au département des Manuscrits. Il témoigne
de l'affirmation d'un nouveau centre de production de manuscrits
en France. Après la bataille d'Azincourt en 1415, les Anglais
s'installent à Paris. Les enlumineurs vont chercher fortune
dans d'autres villes. C'est ainsi qu'Amiens devient un centre très
actif durant les années 1430-1450". Le livre d'heures
de Jacques de Châtillon, né de cette période
brève mais intense de production, a vraisemblablement été
réalisé à Amiens. "Il témoigne
de la confluence du réalisme flamand et du style courtois
encore en vogue à Paris, dit encore François Avril.
Et, plus largement, du dialogue établi à cette
époque entre les artistes du Sud et ceux du Nord, qui a fait
évoluer la représentation picturale."
La plupart des enlumineurs du Moyen Age sont restés anonymes.
Cependant, il est possible de dénombrer au moins quatre peintres
différents pour ce manuscrit. Il s'agit du Maître de
Raoul d'Ailly, auteur de plus de la moitié des enluminures
et du diptyque des premiers commanditaires, du Maître des
Heures Lamoignon, du Maître de Châtillon (ainsi appelé
d'après ce manuscrit) et du Maître des Heures Walters
281. Les éléments ajoutés pour Louis de Roncherolles
furent exécutés par le Maître de l'échevinage
de Rouen vers 1470-1480.

Comme la plupart des livres d'heures, le manuscrit proprement dit
est composé de six éléments principaux : un calendrier,
des extraits des Evangiles, l'office de la Vierge, les psaumes de
la pénitence, l'office des morts et les suffrages des saints.
C'est sans doute un assistant particulièrement doué
du Maître d'Ailly qui a peint les 24 illustrations du calendrier
: l'activité du mois - un faucheur de blé pour juin
- à laquelle correspond, au verso, le signe du zodiaque.

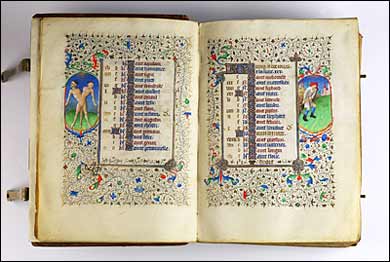

Le Maître de Raoul d'Ailly exécuta les 27 peintures
des suffrages où sont figurés les saints, objets de
la dévotion du couple des Châtillon.
Les psaumes de la pénitence s'ouvrent sur l'histoire de
David se repentant de ses fautes, scène prolongée
dans les marges de petits médaillons racontant les amours
de David et de Bethsabée. L'office des morts donne lieu à
une scène de funérailles d'un réalisme accentué
par la présence du cercueil au premier plan. L'un des principaux
éléments de ce livre d'heures est l'office de la Vierge.
Œuvre d'un artiste de tout premier ordre que l'on appelle le
Maître de Châtillon d'après ce manuscrit, le
seul où l'on ait reconnu sa main. Cet office est divisé
en huit heures canoniales, chacune ornée d'une image. Au
lieu du cycle de l'enfance du Christ présenté habituellement,
c'est l'enfance de la Vierge qui est ici évoquée.
"Les raisons de ce choix iconographique assez rare sont
peut-être liées à l'histoire des commanditaires.
Le couple n'avait pas d'enfants, malgré la nombreuse postérité
avec laquelle ils ont souhaité être représentés
sur le diptyque. Or, à l'origine de la naissance de Marie,
se trouve l'histoire d'un couple stérile", commente
François Avril. L'évocation des circonstances miraculeuses
de la naissance de la Vierge marque sans doute l'espoir de Jacques
de Châtillon et de sa femme d'obtenir une postérité.
Le deuxième propriétaire voulut, lui aussi, apposer
sa marque au précieux manuscrit. Il fit ajouter notamment un
deuxième diptyque, pendant du premier, le représentant
avec sa femme Marguerite de Châtillon, et plusieurs miniatures
de saints, réalisées par le même artiste ainsi
que les additions qui figurent à la fin du volume. En clôture
du manuscrit, la Complainte de la demoiselle, méditation
sur la fragilité du corps féminin, témoigne de
la délectation du Moyen Âge pour le macabre.
" Ce manuscrit fortement personnalisé est aussi le
reflet du goût et de la piété de ses mécènes
successifs ", conclut François Avril.
Sylvie Lisiecki
|
 |
|
Le livre d'heures tire son
nom des huit heures, dites canoniales, constituant les offices
qui scandaient les journées du chrétien.
|

|
Le livre d'heures, un objet
culte
Le livre d'heures était
le livre de dévotion favori des laïcs. Il apparaît
tardivement au Moyen Âge et s'inspire en partie du bréviaire
utilisé par les prêtres. Le genre s'est surtout
répandu au XIIIe siècle. Sa production prit
son essor au XIVe siècle et se poursuivit à
partir du XVIe siècle sous forme imprimée. Chaque
fidèle veut avoir son livre d'heures, signe extérieur
de richesse et de statut social, ce bel objet contribue au
lustre des familles. Il est intégré au trousseau
des jeunes filles à marier et sert aussi bien de "
livret de famille " : à la fin ou au début
du manuscrit, des feuillets laissés en blanc permettaient
parfois d'inscrire la date de mariage du couple et les naissances
des enfants. Un monde sépare les ouvrages de séries
copiés à des milliers d'exemplaires et les manuscrits
luxueux et très personnalisés peints par les
meilleurs artistes du temps pour des mécènes
exigeants qui faisaient ajouter ou retrancher des prières
au gré de leurs dévotions personnelles. Ceux-ci
pouvaient intervenir dans le choix et le traitement des illustrations.
Exceptionnellement, les commanditaires payaient les pigments
et même les fournissaient.

 |
 |
La production de livres d'heures s'est
poursuivie jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore,
ils suscitent l'intérêt des bibliophiles du monde
entier. Le livre d'heures de Jacques de Châtillon est
le seul représentant, et probablement le plus beau, restant
en France de la production amiénoise des années
1430-1450. Parmi les livres d'heures les plus célèbres
conservés à la BnF : Les Petites Heures (env.
1385), Les Très Belles Heures (entre 1390 et 1410) et
Les Grandes Heures (1409) de Jean de Berry ; Les Grandes Heures
de Rohan (vers 1430-1435), Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne
(vers 1503-1508).
Parmi les livres d'heures les
plus célèbres conservés à la BnF
:
Les Petites Heures (env.
1385), Les Très Belles Heures (entre 1390 et 1410) et
Les Grandes Heures (1409) de Jean de Berry ; Les Grandes Heures
de Rohan (vers 1430-1435), Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne
(vers 1503-1508). |

|
Histoire d'un manuscrit
DU PATRIMOINE PRIVE AU PATRIMOINE PUBLIC
Le manuscrit a traversé
près de six siècles sans presque aucun dommage.
Fait rare, le manuscrit a gardé sa reliure d'origine,
à ais de bois recouverts de veau estampé à
froid, à petits fers.

Inconnu des spécialistes, ce livre d'heures est resté
en mains privées jusqu'à nos jours, passant
par héritage de famille en famille. Il a servi de "
livret de famille " au XVIe siècle à la
famille de Roncherolles.

Désirant s'en dessaisir, les héritiers actuels,
conformément à la législation française,
déposèrent une demande de certificat de libre
circulation permettant sa mise en vente à l'étranger.
En raison de la valeur artistique exceptionnelle de l'œuvre,
le département des Manuscrits de la BnF, chargé
de statuer en tant qu'expert en la matière, n'accéda
pas à cette demande. Le ministère de la Culture
a ainsi pu s'en porter directement acquéreur auprès
des vendeurs. Ce superbe manuscrit fera l'objet d'une présentation
qui permettra au public de mieux le découvrir.
Bibliographie
François Avril et Nicole
Reynaud, Les
Manuscrits à peintures en France, 1440-1520,
Paris, Flammarion/BnF, 1993, réed. 1995.
Susie Nash,
Between France and Flanders
: Manuscript Illumination in Amiens in the Fifteenth Century,
Londres, Toronto, 1999.

|
|