 |
Le saint-simonisme a façonné une
grande partie du XIXe siècle. La BnF lui consacre
une exposition à la bibliothèque de l'Arsenal,
qui conserve le fonds constitué par Enfantin
lui-même, le principal dirigeant de ce mouvement. En rendant
ses archives accessibles
au public par un testament en faveur de la bibliothèque,
ce dernier accomplit, en 1864,
son dernier geste militant.
 |
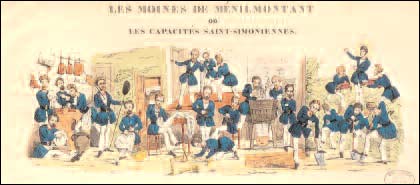
Les moines de Ménilmontant
ou les capacités saint-simoniennes. Lithographie
coloriée. © Bnf/Bibliothèque de l'Arsenal. |

Le saint-simonisme s'est développé à partir
de 1825, au lendemain de la mort du comte de Saint-Simon,
représentant de la fine fleur de l'aristocratie française
– et arrière-cousin du mémorialiste du règne
de Louis XIV – qui prit
fait et cause pour la Révolution française, au
point de renoncer à son titre nobiliaire et de s'engager
dans une carrière d'entrepreneur. Passé la quarantaine,
Saint- Simon se fit philosophe et prophétisa la venue
d'un "âge d'or", pour peu que fût renversée
la hiérarchie des élites et que les rênes
du pouvoir fussent confiées aux savants et aux "
producteurs".
Il prôna un retour à la morale paulinienne de l'amour
fraternel, un "nouveau christianisme" régénérateur
de la pureté religieuse dévoyée par l'Église.
Son œuvre jette les fondements d'un monde nouveau, industriel,
et d'une société tout entière tournée
vers l'amélioration des conditions d'existence de "la
classe la plus pauvre". L'héritage intellectuel
de Saint-Simon fut fécondé par une poignée
de fidèles rassemblés autour de son lit d'agonie,
eux-mêmes ensuite rejoints par de nombreux disciples,
hommes et femmes, ingénieurs et ouvriers, à Paris
et en province. Le mouvement s'organisa rapidement et orchestra
une propagande efficace en trois temps : l'édition de
journaux et de brochures, une "exposition" publique,
orale et enflammée des fondements de la doctrine, et
enfin une présence visible et multiforme dans les rues,
tant en province qu'à Paris. Enfantin a scellé
le destin du groupe en en faisant le théâtre d'un
spectacle permanent : en 1832, après un débat
fratricide sur les modalités de l'émancipation
féminine et face à la montée des tracasseries
policières, le "Père" de la religion
saint-simonienne se retira avec quarante de ses "fils"
dans sa maison de Ménilmontant, afin d'y vivre, quelques
mois durant, dans une communauté égalitaire.
Les quarante avaient signifié leur renoncement au monde
en revêtant un costume tricolore dont le gilet, symbole
d'entraide, s'attachait dans le dos. Cet éphémère
épisode a fait entrer les saint-simoniens dans l'histoire
sous la bannière du socialisme utopique et comme les
apôtres exaltés d'une religion alternative vouée
au développement de l'industrie et au progrès
social. Mais le panache du geste collectif ne masque qu'à
peine l'échec du militantisme saint-simonien : inculpés
de réunions publiques illicites, d'outrages aux bonnes
mœurs et d'escroquerie (prévention qui ne put être
retenue contre eux), les saint-simoniens furent contraints à
la dispersion et leurs trois principaux dirigeants, condamnés
à la prison ferme.

Une image critique et exigeante de
notre modernité
L'ambition de l'exposition qui leur est consacrée est
de suivre la destinée des anciens apôtres au-delà
de la dispersion ordonnée en 1832, dans leurs carrières,
souvent brillantes, d'hommes publics, de journalistes ou d'hommes
d'affaires. Les plus à même d'être séduits
par le slogan saint-simonien : "À
chacun selon ses capacités, à chaque capacité
selon ses œuvres ", étaient en effet
les ingénieurs. Nombre de jeunes adeptes étaient
issus des rangs de Polytechnique, avides de mettre en œuvre
de grands projets pacifistes de communication et d'échanges.
En ordre dispersé et jusque dans leurs oppositions, ils
n'en ont pas moins continué, toute leur vie durant, à
tisser entre eux un réseau d'idées et d'entreprises
qui leur a donné un véritable pouvoir sur leur
siècle.
On sait peu que le premier chemin de fer français a été
construit et financé par les saint-simoniens et que l'ensemble
du réseau ferré, dont le Paris-Lyon-Méditerranée,
porte leur empreinte ; qu'ils ont eu une part déterminante
dans la révolution bancaire et industrielle de la seconde
moitié du XIXe siècle à travers
le Crédit mobilier des frères Pereire,
mais aussi en contribuant à la fondation de quelques-unes
de nos plus grandes banques et entreprises, comme le Crédit
Lyonnais, le CIC et la Compagnie Générale des
Eaux.
On ignore que le canal de Suez, grand ouvrage à vocation
économique et, dans l'esprit saint-simonien, lien organique
entre l'Orient et l'Occident, fut réalisé d'après
leurs études ; que le traité de libre-échange
de 1860 entre la France et l'Angleterre fut négocié
du côté français par les saint-simoniens
Michel Chevalier et Arlès-Dufour
; enfin que la Ligue internationale de la paix et de la liberté,
première organisation non gouvernementale vouée
à l'édification d'un état de droit international,
fut présidée à Genève, pendant vingt
ans, par Charles Lemonnier, un
ancien apôtre.
Le saint-simonisme unit deux idéologies que le XXe
siècle nous a appris à opposer, le libéralisme
et le socialisme. Il ne cesse, presque deux cents ans après
son éclosion, de nous renvoyer une image critique et
exigeante de notre modernité.
| Nathalie Coilly
et Philippe Régnier |

Le siècle des saint-simoniens, du Nouveau
Christianisme au canal de Suez
28 novembre 2006 - 25 février
2007
Bibliothèque de l'Arsenal (entrée libre).
Commissariat : Philippe Régnier,
directeur de l'unité mixte de recherche littérature,
représentations, idéologies aux XVIIIe
et XIXe siècles (LIRE), CNRS et Nathalie
Coilly, conservatrice à la bibliothèque
de l'Arsenal.
En partenariat avec France Culture. |
| |
|
|